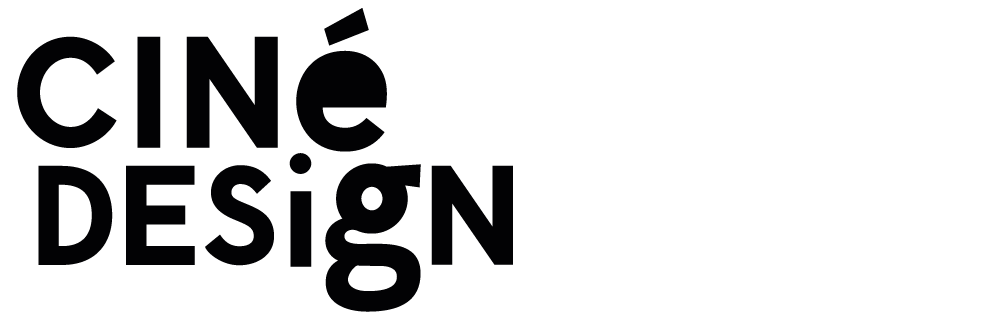Panne des imaginaires technologiques ou design pour un monde réel ?
Cette contribution a pour origine la lecture d’un essai du chercheur Nicola Nova intitulé Futurs ? La panne des imaginaires technologiques (2014). Empruntant cette expression au futurologue Philippe Gargov, Nicolas Nova part d’un premier constat : la majorité des productions de science-fiction comprendrait des objets imaginaires dont le décalage avec notre quotidien ne s’est pas réduit. Peter Thiel (fondateur de PayPal et investisseur de Facebook) notait ainsi, ironiquement, en 2011, que « nous voulions des voitures volantes, et [que] nous avons eu à la place 140 caractères ». Ce décalage entre ce qui était promis comme futur par les imaginaires cinématographiques et les technologies effectivement réalisées démontrerait que « la science-fiction a perdu de son influence comme force d’inspiration sur le futur » (Nova, 2014, 5). Le deuxième constat de l’ouvrage est que la science-fiction aurait de plus en plus de difficulté à générer des nouveaux « imaginaires technologiques ». En usant de motifs formels mis au point il y a plus de quarante ans (Nicolas Nova donne en exemples les gratte-ciels, les lunettes et casques de « réalité virtuelle », les robots humanoïdes, etc.), la science-fiction se contenterait de remâcher le passé plutôt que d’explorer de nouveaux types de sociétés. Cette « perpétuation de mythes », (Nova, 2014) qui proviennent aussi bien de la science-fiction que des cultures populaires et des des publicités qui les propagent conduirait à une « panne des imaginaires » ayant pour conséquence un sentiment d’atemporalité : le futur aurait disparu (Bublex & During, 2014).
Face à ces enjeux, depuis ma position de designer, il est intéressant d’examiner si le design n’a pour dessein que de perpétrer ou de créer des stéréotypes, ou s’il devrait plutôt avoir pour tâche de pluraliser des typologies installées parmi nous. Si cette question peut sembler triviale, de nombreuses productions relèvent pourtant de la première catégorie. Le champ du design publicitaire, par exemple, repose en grande partie sur des stratégies comportementales visant à embrasser l’attention du plus grand nombre et recourt donc, bien souvent, à l’entretien de clichés. Dès lors, si on envisage positivement le design comme une capacité de transformer le monde en donnant forme et sens à des cultures et à des environnements, ses relations avec les productions audiovisuelles de science-fiction méritent d’être examinées. En effet, un des fondements du design est que ce dernier ne prendrait sens qu’en raison de sa faculté « opérationnelle », aspect mis en évidence par le designer Victor Papanek dans son ouvrage au titre éloquent de Design pour un monde réel (1974[1971]). Écrit en opposition aux productions qui ne répondent pas à des « besoins », l’auteur y fustige dès les premières lignes un design qui ne s’adresse qu’à une élite. Si l’on met cette thèse en regard des impasses des productions sciences-fictives, on peut donc se demander si le design a pour but d’exprimer de nouvelles représentations du futur, ou s’il doit au contraire s’attacher à travailler « pour un monde réel ».
Afin de clarifier nos analyses, nous reprenons ici la définition habituelle de la science-fiction, à savoir un genre narratif (principalement littéraire et cinématographique), structuré autour d’hypothèses à caractère temporel concernant ce qu’aurait pu être le passé, le présent (uchronie), ou le futur (anticipation). Dans le cadre de cette réflexion, nous nous limiterons aux productions filmiques, tant sérielles que cinématographiques. En effet, de par leur caractère visuel et leur répétition par les mass médias, ces dernières sont davantage susceptibles d’interagir avec la conception d’objets potentiellement commercialisables. Les objets acquièrent un caractère « fétiche », voire auto-réalisateur : leur insertion dans la narration n’épuise pas le désir de pouvoir les manipuler en dehors de la diégèse. L’intersection entre les champs du cinéma et du design prend alors sens pour interroger le double présupposé d’une dévaluation supposée des imaginaires dans les productions filmiques de science-fiction, et d’un design ayant communément pour but principal de mettre en œuvre une solution à un besoin. Alors que d’autres approches du design s’ancrent dans des propositions de scénarios prospectifs (prenant appui sur des problématiques émergentes), nous pouvons nous demander en quoi ce design « producteur d’imaginaires » peut, ou non, s’ancrer dans du réel. Il faut pour cela commencer par mettre au clair les rapports entre la science-fiction et l’incarnation de nouveaux futurs afin de nuancer l’idée selon laquelle la science-fiction serait « en panne ». Puis, après une étude des relations du design à la notion de « besoin », nous nous demanderons si le design comme la science-fiction ne gagneraient pas à être envisagés en termes de « potentialités » pour dépasser des approches réductrices uniquement basées sur la fonctionnalité.
→ La science-fiction échoue-t-elle vraiment à proposer de nouvelles visions de l’avenir ?
L’essai de Nicolas Nova fournissant des arguments contredisant ou nuançant les deux constats formulés en introduction, à savoir que d’une part le futur promis par les films de science-fiction ne se serait pas réalisé, et que d’autre part la science-fiction échouerait à produire de nouveaux imaginaires, il est tout d’abord utile de les synthétiser et de les extrapoler sous forme d’une série de « contre-arguments » :
• la science-fiction n’a pas pour rôle de prévoir le futur, ni même d’être « utile »
Nicolas Nova montre que l’argument selon lequel la science-fiction devrait prévoir le futur provient d’une confusion avec le champ de la futurologie. Si la science-fiction peut certes anticiper ou permettre de réaliser des objets technologiques, « les prédictions ne sont qu’un effet de bord de la science-fiction », comme le dit le scénariste de comics Warren Ellis (Nova, 2014). Une autre imprécision consiste à attribuer la paternité d’inventions techniques à des productions de science-fiction qui n’y sont pas directement reliées. L’Internet, tel que l’on connaît aujourd’hui, n’a par exemple pas grand-chose à voir avec les fictions cyberpunks décrivant des réseaux d’information totalitaires.
• la science-fiction n’a pas pour vocation de transformer le monde, mais de divertir
La science-fiction, au cinéma notamment, peut avant tout être comprise comme une manière de nous arracher d’une quotidienneté vécue comme routinière et ennuyeuse. Un/e auteur/e (réalisateur/trice, scénariste, etc.) est bon/ne quand son histoire est intéressante (émotionnellement, formellement, etc.), ce qui n’est pas le cas des designers qui certes travaillent à partir de scénarios, mais orientés vers des propositions de modes de vie, voire vers des politiques de civilisation : leurs finalités ne sont pas les mêmes.
• les motifs changent de sens suivant le contexte
Le plaisir de regarder des œuvres peut découler de la répétition et de la variation de mêmes topoï (thèmes récurrents). Dans son essai Le sujet dans le tableau (1997), l’historien de l’art Daniel Arasse note ainsi que « chaque cas [artistique] affronte l’approche historique ». En mettant l’accent sur la tension entre « l’instance singulière et intime [de l’artiste] qui travaille à s’approprier en le déformant secrètement le message de l’œuvre » (les scènes bibliques par exemple), Arasse formule une « théorie du singulier » où le sens prend forme à partir d’écarts et d’anomalies. Sa distinction entre l’« imitation » et la « ressemblance », transposée au contexte des industries culturelles, peut nous inviter à nuancer des constats trop hâtifs suivant lesquels les productions audiovisuelles de science-fiction seraient les mêmes en raison de l’utilisation de mêmes matériaux de base. Par exemple, entre l’abstraction du robot Tars dans le long métrage Interstellar (2014) et l’anthropomorphisme de Ava dans Ex Machina (2014), parle-t-on vraiment de la même chose ? Au sein d’une même franchise, on peut également observer des déplacements et des hésitations ainsi que l’a montré Pia Pandelakis dans une réflexion sur les contrariétés de la « masculinité » dans son étude d’Iron Man (Pandelakis, 2017).
• il ne sert à rien de concrétiser tels quels les objets de la science-fiction
Bien que la science-fiction n’ait pas vocation à intervenir dans le réel, le fait qu’elle mette en scène des objets dans des situations d’usage plausibles (du moins dans le cadre de fictions) entraîne ce que le chercheur Elie During appelle dans son ouvrage, co-écrit avec l’artiste Alain Bublex, un « effet performatif » (Bublex & During, 2014) : une fois que ces objets apparaissent et deviennent populaires, il devient possible, voire souhaitable, de les réaliser. On ne compte plus les articles de recherche, surtout dans le champ de l’ingénierie, consacrés à des tentatives de concrétisation d’objets de science-fiction : le « Tricorder » de Star Trek (1966 —), les « cyberpunk glasses » de Johnny Mnemonic (1994), la « invisible cloak » (cape d’invisibilité) de Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) ou de Ghost in the Shell (1995), le « hoverboard » de Back to the Future Part II (1989), ou encore les interfaces gestuelles de Minority Report (2002). Mais alors que ces objets font sens dans leur mise en scène cinématographique, leur transposition sans recul critique dans le « monde réel » ne peut être que déceptive. Ces « solutions en attente de problème » (Nova, 2014) participent elles aussi d’une forme de blocage des imaginaires. Le manque de considération de certain/e/s chercheur/se/s (en ingénierie, en interaction humain-machine, etc.) pour les enjeux sociaux et politiques des technologies numériques, se révèle, après coup, inopérant à agir dans le réel.
• la science-fiction s’est faite distancer par le réel
Contrairement à ce qu’un constat trop rapide pourrait donner à penser, certaines inventions des productions sciences-fictives se sont bien réalisées. En 1969, le premier être humain sur la Lune clôt un certain imaginaire lié à la conquête spatiale, et participe par là d’une possible « fin des grands récits » (Lyotard, 1979) – thèse prolongée par les chercheurs Jean Baudrillard (1981) et Fredric Jameson (2007 & 2008[2005]), qui ont mis en doute les valeurs du mouvement moderne. Cette méfiance quant à un avenir grandiloquent, optimiste et utopique (crises écologiques, militaires, économiques, etc.) signe le déclin de la science-fiction comme horizon d’espoir et explique, peut-être, le succès d’autres genres fictionnels tels que la fantasy ou le survivalisme (films de zombies, etc.). De plus, l’étude sociologique voire ethnographique (Nova, 2014) des nouvelles technologies conduit à découvrir des comportements aussi étranges que ceux relatés dans les fictions de Ray Bradbury, Philipp K. Dick ou Isaac Asimov. Dans cette hypothèse, il n’y aurait pas de « panne des imaginaires » : c’est juste qu’on ne regarderait pas au bon endroit.
• la science-fiction ne parle pas du futur mais du présent
Selon Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs (Yverdon-les-Bains, Suisse), « la science-fiction est avant tout l’exploration de lignes de force qui polarisent le présent. Elle n’explore pas l’avenir mais explore le présent sur le mode d’un miroir distancié » (Nova, 2014). Dépassant l’opposition entre imaginaire et réel, cette idée fait qu’il serait vain de reprocher à la science-fiction d’échouer à représenter le futur, puisque celle-ci consisterait avant tout à explorer des potentiels non actualisés dans le présent, à « savoir identifier les motifs, les schémas [et] les singularités d’aujourd’hui » : « La contribution principale [des auteurs de science-fiction] réside [...] dans les récits qu’ils produisent, les mondes imaginaires qu’ils créent et les évolutions possibles de nos sociétés qu’ils explorent » (Nova, 2014).
→ Le design, une simple affaire de « besoins » ?
Au regard de ces différents contre-arguments, on comprend que nombre d’accusations quant à une supposée « panne des imaginaires technologiques » méritent d’être reformulées. Mais le problème posé en introduction demeure intact, à savoir que la science-fiction, qui extrapole des problématiques concernant le présent, échouerait cependant à le transformer car elle ne s’intéresserait pas, contrairement au design, à des « besoins réels ». Cette compréhension du design est celle qu’appelait de ses vœux le designer Victor Papanek, qui plaidait dès les années 1970 pour une prise en compte des problèmes concrets rencontrés par des populations laissées de côté par un design qu’il considérait comme élitiste et nombriliste. Or ce « design pour un monde réel », réducteur d’inégalités, entre directement en conflit avec des projets pouvant relever du champ de la science-fiction :
[…] Avant la fin du siècle [la citation se référant à 1968], des hommes vivront probablement une partie du temps dans des colonies lunaires sous dôme. Mais on ne peut pas se permettre de négliger le nécessaire d’aujourd’hui au profit du superflu de lendemains incertains. […] C’est plus amusant que de se colleter avec des problèmes bien réels. De plus, il est dans l’intérêt du pouvoir de fournir aux jeunes une évasion du côté de la science-fiction, de peur qu’ils ne prennent conscience de la dure réalité.
Le design aura son mot à dire lorsque l’homme ira s’établir au fond de l’océan ou sur des planètes lointaines. Mais l’un et l’autre voyage dépendent pour une lourde part de l’environnement créé ici et maintenant. Lorsque des jeunes gens sont plus capables de construire un casino sur la planète Mars que de décrire les conditions de vie dans une ferme du Sud des Appalaches, c’est que quelque chose ne tourne pas rond. (Papanek, 1974[1971], 291-292).
Reprochant à la science-fiction de détourner les designers des enjeux sociaux – peut-être ne peut-il pas encore anticiper l’écart entre les fictions amorcées par la science ou par la design ? –, Papanek expose dans son ouvrage de nombreux cas d’objets concrets réalisés par ses étudiant/e/s en collaboration avec des populations dites défavorisées. Le paradoxe est que bien d’autres exemples exposés dans son essai sont le fait d’amateur/trice/s (du moins de personnes qui ne revendiquent pas le design comme activité professionnelle). Autrement dit, Papanek démontre en creux – malgré lui ? – qu’il n’y a pas besoin de designers pour que le monde fonctionne, ou pour que des besoins soient résolus. Nous pourrions ainsi objecter à Victor Papanek qu’une compréhension du design fondée sur la réponse à des besoins est peut-être nécessaire, mais non suffisante. Non seulement, comme le dit Gaston Bachelard, l’être humain est une création du désir et non du besoin (Bachelard, 1992[1949]), mais plus encore : si le design tient à l’art, comme dans la vision inaugurale énoncée par Walter Gropius lorsqu’il fonde le Bauhaus au début des années 1920 (« L’Art et la Technique – une nouvelle unité », « Kunst und Technik – eine neue Einheit »), c’est bien qu’il comporte une part essentielle pour nous qui ne relève pas de la nécessité. Il y aurait ainsi « design » quand les artistes cessent de s’opposer à l’industrie et travaillent avec elle, en tension, dans une recherche de « qualités » (tactiles, sonores, graphiques, etc.) – dont ne se soucient guère la « seule » production industrielle et la stricte réponse à des besoins.
→ Fictions « inférentielles » et fictions « potentielles »
On peut aussi trouver étrange le fait que Papanek rende les designers responsables de nombreux maux dès la première ligne de son ouvrage (« Peu de professions sont plus pernicieuses que le design industriel »), comme si les facteurs socioéconomiques ou politiques n’avaient rien à voir avec le fait qu’il existe des objets nuisibles (quid de la responsabilité des commanditaires ?). Aussi, plutôt que d’accuser la science-fiction et le design d’échouer à « réellement » transformer le monde réel, nous proposons de retourner la situation et de nous demander s’il ne faudrait pas remettre en cause ce fameux « monde réel », qui, s’il s’oppose à la fiction, nous prive également d’alternatives quant aux façons dont nos sociétés sont organisées. Condamner les fictions au nom d’un réel supposé stable et extérieur est illusoire, puisque comme le montre le chercheur Thomas Pavel, les œuvres de fiction ne peuvent s’appréhender par le seul « biais de la référence à l’univers dans lequel nous vivons » (Pavel, 2003). Il nous faut également, selon Pavel, résister à la tentation selon laquelle « la fiction doit quand même renvoyer à quelque réalité palpable qu’il s’agirait de découvrir, de préférence dans la vie personnelle de l’auteur ou dans l’organisation sociale et politique de son monde ». Pavel propose ainsi de renoncer à « l’approche référentielle » de la fiction, au profit d’une « force inférentielle** » :
Le caractère inférentiel, pour sa part, assure aux œuvres de fiction, même à celles qui semblent les plus éloignées du monde empirique, la capacité de signifier de manière aussi pertinente que les autres formes de discours. [Cette] action ouvre à la fiction un horizon d’inférences plus vaste que celui offert par l’expérience. L’art du langage étant donc ipso facto celui de la généralité et des inférences, la fiction participe en égale mesure de la liberté de l’invention et du souci de pertinence. Loin d’être un discours déficitaire, voire dangereux de par son incapacité à établir des rapports fiables avec la réalité environnante, la fiction rachète en réalité le laisser-aller de ces rapports par la prolifération d’inférences significatives (Pavel, 2003).
Nous pouvons à présent répondre à la problématique formulée au départ, à savoir examiner si le design a pour but d’exprimer de nouvelles représentations du futur, ou s’il doit au contraire s’attacher à travailler pour un monde réel. Travailler à pluraliser les fictions permet d’ouvrir des potentialités dans le présent, laissées sous silence par le poids des traditions, des valeurs économiques ou des stéréotypes. Mais, pour aller plus loin, nous avons à présent besoin de distinguer différents registres de fictions car toutes ne rentrent pas dans cette démarche d’ouverture. En ce sens, il y aurait des situations de science-fiction « bloquantes » pour la pensée lorsqu’une technique n’est abordée que dans une seule direction, qu’elle soit « solutionniste » (Morozov, 2014) : la technologie pourrait parer à tous les problèmes du monde, ou catastrophique : la technologie conduirait nécessairement à la ruine. Il faut dépasser cette alternative en faisant l’hypothèse que le design ne doit ni représenter de nouvelles visions du futur, ni travailler pour un monde réel, mais œuvrer à ouvrir des « potentialités » dans le présent, c’est-à-dire des fictions dont certaines seront plus soutenables que d’autres. Mais il faut également dépasser l’opposition entre « futur » et « présent » en se replaçant du point de vue du projet : il s’agit alors de mesurer le paradoxe entre un futur formulé dans la notion même de « pro-jet » (vers l’avant) et le fait que ce dernier doive nécessairement s’ancrer dans un présent identifié, originel, à partir duquel il ne réalisera qu’en disparaissant (Gunthert, 2017). Ces jeux d’aller-retour permettent de reconsidérer les relations entre la science-fiction et le design en prenant parti pour des productions qui sont riches de sens lorsqu’elles mettent en évidence des failles, des lignes d’errance, des impasses et des possibilités de détours. La capacité « inférentielle » (Pavel, 2003) de la fiction montre que d’autres mondes peuvent être fabriqués, des mondes ni plus ni moins réels que d’autres.
Design et cinéma peuvent alors se rejoindre à propos de ce que l’écrivain Camille de Toledo appelle « fiction potentielle » (2016), à savoir la mise au point d’alternatives et l’élargissement de situations a priori fermées à tout changement : « À la différence des fictions qui défendent, soutiennent, construisent et conservent la réalité, les fictions potentielles œuvrent à des histoires inachevées, des histoires où nous avons une part » (de Toledo, 2016, 26). Il s’agit, sous le terme de « potentiel », de faire en sorte que le présent puisse toujours bifurquer : « Ce que la pensée potentielle définit comme réel, c’est la capacité transformatrice » (de Toledo, 2016, 57). Rien de plus terrible, en ce sens, que des déclarations comme celles de Margaret Thatcher, alors Première ministre du Royaume-Uni, qui déclarait dans les années 1980 « qu’il n’y a pas d’alternative » (« There is no alternative ») à l’économie de marché – formule reprise par l’architecte Rem Koolhaas dans un ouvrage à l’ironie ambiguë, où il affirme que « la consommation est notre oxygène [et qu’il] n’y a pas d’autres alternatives » (Koolhaas, 2001). Allant à l’encontre de cette vision fataliste du capitalisme comme « milieu » ne pouvant souffrir d’aucune contestation, nous devons soutenir la possibilité, pour les designers – en tant qu’ils sont des êtres humains (Huyghe, 2014) – de toujours pouvoir modifier leurs environnements de vie :
Souhaitons-nous transmettre des possibles ou renforcer des régimes d’impossibilités, de fins ?
Cherchons-nous à étendre des capacités ou à restaurer des pouvoirs ?
Voulons-nous célébrer toujours des puissances établies ou traduire des voix nouvelles ? Est-ce notre devoir de consolider des clôtures ou de rouvrir
l’Histoire aux devenirs ? (de Toledo, 2016, 47)
→ Cinéma et design, quelles potentialités de transformation du réel ?
Les enjeux sociopolitiques ne sont pas l’apanage des designers, comme on pourrait le croire à lire Victor Papanek. Prenant ses distances avec l’idée que les designers seraient porteur/se/s d’une « responsabilité » spécifique impliquant tant des mœurs que de la morale, le philosophe Pierre-Damien Huyghe note que :
La question est de savoir si dans les dispositifs de production, plus ou moins captés par les forces économiques [...], il y a du jeu pour que les humains se posent des questions et les traitent non pas en tant que spécialistes mais en tant que responsables d’une manière générale. Cela implique quelque chose quant à l’administration économique des forces productives. (Huyghe, 2008)
Cet espace de conscience recoupe la notion d’ouverture développée par Camille de Toledo. Afin d’examiner quelles formes peuvent prendre de telles potentialités, nous proposons d’examiner en guise de conclusion trois cas d’intersection entre cinéma et design, qui montrent que la science-fiction peut permettre de reconsidérer les façons dont se partagent les responsabilités au sein des poussées techniques contemporaines.
• s’affranchir des stéréotypes
Malgré le fait que les robots ne possèdent pas de caractéristiques biologiques, de nombreuses productions audiovisuelles de science-fiction reconduisent pourtant des stéréotypes de genre (Masure & Pandelakis, 2017). Il existe, heureusement, des exceptions. Dans le film Her (Jonze, 2014), des intelligences artificielles (AI) vocales, permettent à leurs possesseurs de répondre à de nombreux besoins (tri d’information, etc.). En rencontrant l’amour de son partenaire humain (le personnage de Theodore Twombly dans la diégèse), l’AI Samantha va progressivement s’émanciper de cette relation instrumentale, et par là rencontrer la déception et le manque, notions qui caractérisent in fine tout rapport au désir. Camille de Toledo fait ainsi de Her un cas possible permettant de distinguer entre des « fictions de clôture » (conservatrices, etc.) et des « fictions potentielles » (qui considèrent « l’éthique et la politique d’un régime fictionnel ») :
Si les multiples productions hollywoodiennes de la fin des temps sont si répétitives et politiquement conservatrices, c’est qu’elles entretiennent la culture apocalyptique. En ce sens, ce sont des fictions de clôture. Au contraire, si un film comme Her de Spike Jonze est si problématiquement éprouvant, c’est qu’il rétablit de l’infini, un infini algorithmique dans l’économie épuisée du désir. On pourra donc utilement qualifier ce film de fiction potentielle. (de Toledo, 2014, 26)
• mettre en évidence des impasses de conception
Les productions audiovisuelles de science-fiction ne montrent bien souvent que des objets en situation de fonctionnement optimal, qu’ils soient conçus à des fins positives ou négatives. Or la science-fiction peut aussi contribuer à « mettre en scène des problèmes actuels et à venir, des interrogations, craintes et espoirs quant aux frictions entre les différentes strates de la société, dont les sciences et technologies » (Nova, 2014). Deux séries récentes peuvent s’inscrire dans cette visée. Dans Black Mirror (2014-2016), chaque épisode indépendant est construit autour d’un objet technologique, qui n’est pas simplement mis au service d’une intrigue mais ouvert à des usages portant à discussion. À rebours des visions hygiénistes des « assistants personnels » type Google Now, Apple Siri ou Amazon Echo, l’épisode « The Entire History of You » (« Retour sur image », 2011) montre ainsi les conséquences sociales d’une puce implantée derrière l’oreille permettant de stocker ses souvenirs et de les rediffuser – reflet étrange et dystopiques (black) de notre époque et des fantasmes qu’elle projette dans le champ du numérique. Il en va de même dans la série Mr. Robot (2015-2016) qui déroule l’intrigue d’un hack (piratage) d’une multinationale technologique toute puissante. Le premier épisode de la deuxième saison (2016) met en scène un appartement bardé de d’objets dits « intelligents » (« smart objects ») qui tourne au cauchemar, mettant en évidence l’absurdité de truffer notre quotidien de capteurs inutiles. Ces deux productions audiovisuelles incarnent bien l’aphorisme de l’auteur Frederik Pohl, selon lequel « une bonne histoire de science-fiction doit pouvoir prédire l’embouteillage, et non l’automobile » (Nova, 2014).
• renouveler l’étrangeté du quotidien
Avec Black Mirror et Mr. Robot se fait jour une capacité du design à créer des fictions prenant appui sur notre quotidien pour proposer de nouvelles directions de pensée (Coles, 2016). Développé notamment dès le début des années 2000 par les designers Anthony Dunne et Fiona Raby, le « design critique » (« critical design ») rejoint cette visée en « utilisant des propositions de design “spéculatif”, réflexif, pour défier les affirmations rapides, les préjugés et lieux communs sur le rôle des produits dans la vie de tous les jours. Il s’agit plus d’une attitude que d’autre chose, un positionnement plutôt qu’une méthode » (Dunne & Raby, 1999). En créant des objets « placebos » comme des attracteurs d’ondes électromagnétiques, ce « design noir » (black) se joue de nos croyances et invite à regarder autrement nos environnements technologiques. On peut toutefois regretter que ce type de démarche dystopique ne produise que des objets à contempler, et qu’il échoue à proposer des visions positives (Dautrey & Quinz, 2014 ; Cellard, 2017). Souhaitant dépasser ces impasses, le champ du « design fiction », revendiqué notamment par l’auteur Bruce Sterling (2005), propose d’étendre les champs d’action des designers « au delà des formes [et de la résolution de problèmes], pour “designer” le système global de production, de vie et d’interaction de [nouvelles] catégorie[s] d’objets » (Marchetti & Quinz, 2013).
→ Cinéma et design, au-delà du fonctionnel
Travailler au-delà de la notion de « problème » à résoudre implique de passer des scénarios à l’opérationnel. Ces « scénarios pour un futur meilleur » (Nova, 2014) alliant prospective et ancrage opérationnel seront-ils suffisants pour répondre aux défis contemporains, dont la complexité excède une approche basée sur les « besoins » ? Peut-être est-ce là que de nouvelles relations entre cinéma et design restent à inventer, dans des manières d’appréhender des objets (existants ou non) qui ne se limitent pas à du fonctionnel, mais qui soient au fait d’implications sociales, économiques, écologiques, multiculturelles, etc. dont les modalités restent à négocier collectivement. En montrant des inventions techniques dans des situations où ces dernières sont mises à l’épreuve de nos quotidiennetés, celles-ci acquièrent un caractère « étrange » (Dautrey & Quinz, 2014) qui déroute un réel que l’on croyait stabilisé. C’est pourquoi il importe moins d’examiner l’échec d’un futur grandiose qui n’a pas eu lieu que les conséquences de ses réalisations potentielles.
Bibliographie
Arasse, Daniel. 1997. Le sujet dans le tableau. Essais d’iconographie analytique. Paris : Flammarion.
Bachelard, Gaston. 1992[1949] La Psychanalyse du feu. Paris : Gallimard.
Baudrillard, Jean. 1981. Simulacres et simulation. Paris : Galilée.
Bublex, Alain & Elie During. 2014. Le futur n’existe pas : rétrotypes. Paris : B42.
Cellard, Loup. 2017. « Design Fiction. Entre salves disruptives et lueurs d’espoir ». Strabic.fr, [en ligne], http://strabic.fr/Design-Fiction-Sternberg-Press
Coles, Alex (dir.). 2016. Design Fiction, EP Vol. 2. Berlin : Sternberg Press.
Dautrey, Jehanne & Emanuele Quinz. 2014. Strange Design. Du design des objets au design des comportements. Grenoble : It.
Dunne, Anthony & Fiona Raby. 1999. Hertzian Tales. Electronic Products, Aesthetic Experience, and Critical Design. Cambridge : The MIT Press. ———. 2001. Design Noir. The Secret Life of Electronic Objects. Basel : Birkhäuser.
Gunthert, André. 2017. « La menace est-elle une fiction ? ». L’image sociale, [en ligne], https://imagesociale.fr/4461
Huyghe, Pierre-Damien. 2008. « Design, mœurs et morale ». Entretien avec Emmanuel Tibloux. Azimuts 30 : 31-41.
Koolhaas, Rem. 2011[1995-2001]. Junkspace. Repenser radicalement l’espace urbain. Traduit de l’anglais par Daniel Agacinski. Paris : Payot.
Jameson, Fredric. 2007[2005]. Archéologie du futur. Le désir nommé utopie. Traduit de l’anglais par Nicolas Vieillescazes et Fabien Ollier. Paris : Max Milo. ———. 2008[2005]. Penser avec la science-fiction. Traduit de l’anglais par Nicolas Vieillescazes. Paris : Max Milo.
Lyotard, Jean-François. 1979. La condition postmoderne. Paris : Minuit.
Marchetti, Luca & Emanuele Quinz. 2013. « Les basiques du design d’interaction ». Olats.org, [en ligne], https://www.olats.org/livresetudes/basiques/designinteraction/5\_basiquesDI.php
Masure, Anthony & Pia Pandelakis. 2017 (à paraître). « Machines désirantes : des sexbots aux OS amoureux ». Res Futurae 10 [en ligne], https://resf.revues.org
Morozov, Evgeny. 2014[2013]. Pour tout résoudre cliquez ici. L’aberration du solutionnisme technologique. Traduit de l’anglais par Marie-Caroline Braud. Limoges : FYP.
Nova, Nicolas. 2014. Futurs ? La panne des imaginaires technologiques. Montélimar : Les moutons électriques.
Pandelakis, Pia. 2017. « Faces, surfaces & coupés-collés : destinées du visage de Tony Stark dans la saga Iron Man ». In Le super-héros à l’écran Mutations, transformations, évolutions. Sous la direction d'Elie Yazbek (Paris : Orizons).
Papanek, Victor. 1974[1971]. Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social. Traduit de l’anglais par Robert Louis & Nelly Josset. Paris : Mercure de France.
Pavel, Thomas. 2003. « Fiction et perplexité morale ». Fabula.org, [en ligne], http://www.fabula.org/documents/pavel\_bloch.php ——— . 1988. Univers de la fiction. Paris : Seuil.
Sterling, Bruce. 2005. Shaping Things. Cambridge : The MIT Press.
de Toledo, Camille. 2016. « MANIFESTER des possibilités ». In Les potentiels du temps. Sous la direction de Aliocha Imhoff, Kantuta Quiros & Camille de (Paris : Manuella), 19-67.
Médiagraphie
• films
Colombus, Chris. 2001. Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Warner Bros.
Garland, Alex. 2015. Ex Machina. A24, Universal.
Jonze, Spike. 2014. Her. Anapurna Pictures.
Longo, Robert. 1994. Johnny Mnemonic. Alliance Communications.
Nolan, Christopher. 2014. Interstellar. Warner Bros.
Oshii, Mamoru. 1995. Ghost in the Shell. Production I.G.
Spielberg, Steven. 2002. Minority Report. Twentieth Century Fox.
Zemeckis, Robert. 1989. Back to the Future Part II. Universal Pictures.
• séries
Brooker, Charlie. 2011—. Black Mirror [TV]. 3 saisons. 13 épisodes. Channel 4, Netflix. 44-89’.
Esmail, Sam. 2015 —. Mr. Robot [TV]. 2 saisons. 22 épisodes. USA Network. 41-65’.
Roddenberry, Gene. 1966 —. Star Trek: The Original Series [TV]. 3 saisons. 79 épisodes. NBC. 50’.